« Il vaut savoir arrêter de corriger ! ». L’expression est courante dans l’univers des correctrices et correcteurs d’édition et de presse. La correction orthotypographique (soit orthographique et typographique, mais aussi grammaticale) est une discipline de moins en moins pratiquée, généralement mal rémunérée en France, et très souvent mal perçue, quand elle n’est pas considérée superfétatoire. Elle est le fait de gens particulièrement tatillons, dont le rapport aux textes est particulier, à l’excès, parfois. Si ces méticuleux censeurs ne savaient s’arrêter de corriger, de peaufiner, pratiquement rien ne passerait sous presse ou n’apparaîtrait sur les écrans en temps souhaitable. Libres propos sur cette activité guindée et trop souvent négligée…
Voici des années que je reçois le Bulletin de l’Association romande des correctrices et correcteurs d’imprimerie. Et peut-être aussi un bon lustre que je me reproche de ne rien fournir en retour à son association éditrice, l’Arci. L’Arci s’écrit ainsi, et non A.R.C.I. ou ARCI, ou « au long », comme les chiffres ou les nombres (au-delà de dix, mais je m’autorise souvent le long au-delà, l’outrepassant aussi pour le 11 et le 12), parce qu’il s’agit d’un acronyme, sigle prononçable « tel un mot ordinaire » m’indique mon Grand Bob (mon Grand Robert de la langue française). Et au long, on pourrait écrire Association romande des correcteurs d’imprimerie. C’est un vestige du passé. Le nom de cette association de professionnel·le·s (le point médian est recommandé par le Guide du typographe, autrefois romand, pour marquer la féminisation des noms de métiers) a évolué.
Ce fameux bulletin se nomme en fait le Trait d’Union. Avec une T et une U capitales, par dérogation spéciale et ad hoc : c’est graphiquement plus plaisant, de plus, pour un titre, c’est licite. Bizarrement, mon exemplaire, le nº 181 daté « 3-2009 » ne s’ornait pas de ce titre, alors que celui disponible en ligne le comporte. Comme quoi, il faut savoir arrêter de corriger, même en Suisse romande… Or donc laisser partir sous presse le Trait, sans son titre, à l’occasion. Du coup, cela m’a décomplexé, et je vais peut-être adresser à l’Arci mes modestes considérations sur l’emploi de « suite à » au lieu de « à la suite de » et sur la prolifération des comme superflus, grossiers calques de l’anglais (du as de pas mal d’asses), dans la prose des Français·e·s de France (au moins métropolitaine, car je serais étonné qu’on lise dans les DOM-TOM des énormités du genre « nommé comme ministre », même s’il est vrai que pour une certaine Yade, qu’on aimerait voir remplacer par un certain Douillet, il faut faire croire qu’elle n’aurait pas eu son portefeuille « pour de la vraie » : c’est l’incertitude sans gloire du portefeuille français des Sports).
Auparavant, je n’aurais pas osé. Envoyer, moi, pauvre correcteur formé sur le tas, des actualités sur la correction telle qu’elle se pratique en France, aux consœurs et confrères de l’Arci ? Je me souviens encore des fascicules d’apprentissage que me montraient les correcteurs du Pays de Porrentruy. Ancien de L’Alsace-Le Pays de Franche-Comté, il m’arrivait d’aller, lors de mettages (jargon pour « mise(s) en page(s) »), les visiter en voisin. Pour Le Pays, j’étais sec’ de rédac’ de marbre. Le marbre n’était plus en marbre car le temps du plomb avait cédé devant celui de la photocomposition, mais on « marbrait » (mettait de côté) encore des papiers pour une publication différée. Les cahiers des futurs correcteurs de nos voisins me semblaient d’un niveau comparable à ce que peut assimiler un agrégé de grammaire issu de l’E.N.S. française, et c’est ce qui explique ma timidité, ma réticence à communiquer ma prose au respectable et respecté Roger Chatelain, pilier de l’Arci, et l’un des meilleurs orthotypographes de la sphère francophone. J’ai d’ailleurs bien fait de m’abstenir d’y chroniquer à parution le plaisant livre de l’ami Jean-François Lecompte, L’Affaire Dolet, puisque Roger Chatelain en personne le présente dans ce dernier numéro du Trait. Il aurait été dommage de priver Jean-François et son éditeur des remarques de Roger Chatelain sur son ouvrage, lequel y relève « quelques divisions de mots erronées » (voir l’article en ligne). Ou de laisser les lecteurs du Trait dans l’ignorance de la mise en regard qu’il fait du Lecompte avec les observations de l’ami Yves Perrousseaux (dans son Histoire de l’écriture typographique, premier volume, chez Adverbum éd.). Si j’avais fait état de cette Affaire Dolet, Roger Chatelain se serait sans doute abstenu de revenir sur le sujet, et moi-même, j’y aurais vraiment perdu (que n’ai-je d’ailleurs pensé, en évoquant ce livre de Jean-François sur Come4News, à reprendre la somme d’Yves ! Dormais-je ?). De ce côté du Léman, on n’en déplorera pas moins que le Trait se refuse toujours à accentuer les capitales (dont celle du prénom de Dolet), et à capitaliser le a de « affaire » dans le titre. Mais glissons, chacun ses particularités, voire particularismes ou idiosyncrasies.
En tout cas, Roger Chatelain termine son article sur l’épisode des troupes allemandes fondant la statue de Dolet de la place Maubert, à Paris, érigée en 1889 devant une foule de syndicalistes et de libres-penseurs. Au moment où on veut incidemment nous vendre une « identité française » qui découlerait autant du rigoureux calvinisme que d’un catholicisme romain faussement débonnaire ou d’une scientologie bien en cour, c’est une chute qui ne manque pas d’à-propos. Elle me fait d’ailleurs songer qu’il ne serait pas trop étonnant de voir ériger une statue de la Correction (sur le mode de celles dédiées à l’industrie ou au commerce qui, parfois en caryatides, soutiennent les frontons de chambres consulaires), telle une monumentale morte, une gisante efflanquée. De plus en plus, l’édition et la presse s’en dispensent… n’évoquons pas davantage l’autoédition proliférant à présent…
Déjà, pratiquement plus personne ne sait vraiment trop de quoi il s’agit. Je n’aurais que bien peu à rajouter à l’excellente contribution de Sophie Brissaud, auteure – d’ouvrages culinaires, en particulier, pour résumer – et correctrice, et à son commentaire par Jacques André dans le nº 31 des Cahiers GUTenberg (daté de déc. 1998 ; on le trouve un peu partout en ligne). Son « La lecture angoissée ou la mort du correcteur » reste à la correction ce que le Crystal Goblet de Beatrice Warde demeure à la composition typographique des textes courants avec des polices de labeur convenables. Pour autant, il convient de souligner que pour l’auteur ou le journaliste l’ayant pratiquée, la correction professionnelle est une activité schizophrénique ; c’est d’ailleurs pourquoi un auteur, un journaliste ayant pratiqué la correction refuse de se relire en tant que correcteur. Mais, tout comme, dans certains pays, faute d’ouvrage (de commandes) en quantité suffisante, des traductrices et traducteurs s’autorisent à traduire depuis leur langue maternelle vers diverses langues cibles, l’auteur ou le journaliste impécunieux, privé de l’appui d’un service de correction digne de ce nom, doit bien s’y faire.
La correction, Sophie Brissaud l’a parfaitement démontré, ne consiste pas seulement à remplacer des tournures fautives ou des lettres X par des signes de multiplication (soit « × » et non « x »), à polir la couche de la révision orthographique et grammaticale pour passer celle de l’orthotypographie. Primo (qu’on transcrira 1º, avec le signe ordinal masculin et non par un chiffre un suivi de celui du degré), il s’agit de se livrer à une lecture sur le fond. On traquera les incohérences, les anachronismes, tout autant qu’il conviendra de veiller à ce qu’un Louis le quatorzième ne soit pas composé en petites capitales quand le quinzième des Louis se retrouverait avec des grandes. L’erreur, celle qui fait qu’on mélange, en informatique, les octets et les bytes (multiplets, dont l’octet), non seulement au kilo, mais à la tonne, dans un même texte (or les capacités ne sont pas les mêmes en binaire et en décimal), doit être décelée par un processus de « lecture angoissée ».
À l’Agence centrale de presse, la vieille A.C.P. défunte (une nouvelle s’est acquise l’appellation), un chef de desk, soit un redchef-adjoint chargé de la validation avant envoi des dépêches, devait s’astreindre à relire trois fois tout ce qu’il traitait. Théoriquement, le journaliste s’était relu, puis son chef de service l’avait fait rapidement avant de transmettre au desk (le bunker, disait-on ailleurs). Cinq relectures donc. Dont celle, mécanique, qui consiste à balayer mot à mot, signe à signe, sans plus chercher à comprendre : c’est la phase médiane de la validation.
En édition, ou presse écrite, on évoque des relectures de « premières » (de manuscrits ou tapuscrits), et de « secondes » (des textes mis en pages). Il va de soi que la pratique se perd. Pour préserver leurs métiers, graphistes et secrétaires d’édition ou de rédaction tendent à interdire l’envoi de textes mis en pages par les auteurs ou les journalistes. On relit donc encore des textes sous texteurs avant de les revoir tels qu’ils seront publiés, sous logiciel de P.A.O. ou sur sorties des fichiers PDF. Au mieux, le logiciel ProLexis, de Diagonal, aura été utilisé. Au pire, parce qu’on ne dispose que du correcteur automatique intégré nativement au texteur, bien des erreurs de diverses natures subsisteront si une seule relecture, non professionnelle, est faite avant diffusion. Les plus choquantes bévues sont, par exemple, des anachronismes, des mots que l’auteur pensait avoir saisi mais qui resteraient omis, et des impropriétés. Ne parlons pas des impairs juridiques qui pourraient exposer à des poursuites pour injures ou diffamation, des plagiats patents (ce que la correction ne permet guère de déceler, en dépit de l’érudition souvent colossale de qui la pratique en professionnel), des manques criants de certains modes d’emploi qui pourraient provoquer des accidents…
Évidemment, s’il faut savoir cesser de corriger, on se reprochera toujours de n’avoir pas corrigé assez une formule chimique qui pourrait, restée fautive, provoquer une explosion ou un empoisonnement, ou une équation mathématique susceptible de faire perdre des heures et des journées à qui se fonderait sur son inexactitude. Pour ces tâches, des correctrices et correcteurs vraiment formés (ou formé·e·s, version « politiquement gendrée » en Suisse), à double formation et compétence, sont assez correctement rétribués. Pour les tâches de correction de textes moins spécialisés (littérature, presse ou sciences humaines, par exemple), tant bien même supposeraient-elles, si les textes en soient issus de traductions ou d’adaptations, de se référer à l’original, la rétribution est souvent faible, voire indigente.
Tout comme le graphiste ou le metteur en pages qui s’entend énoncer des énormités mais s’exécute et les applique en considérant que « le client a toujours raison », la correctrice ou le correcteur finit par baisser les bras. Et parfois accepter des rémunérations bien en dessous soit de ses qualifications, soit de la somme réelle de travail consacrée à la correction. Que répondre à quelqu’un qui ne voit pas à quoi servent les réglages courants et d’autres modifications avancées des paramètres de ProLexis ? Ou qui vous soutient : « Ah, l’anglais, ce n’est pas mon truc, mais je suis excellent en français ! ». Lequel excellentissime va donc, de ce fait, valider des traductions fautives, des textes orthotypographiquement exécrables, sans percevoir l’utilité de s’adjoindre des services de correction. Les anecdotes de personnes « excellentes en français » qui vous retoquent des corrections ou des formes correctes sont légion. Un exemple ? La forme « à pied » (non pas pour des verres, mais pour la marche, fut-elle celle des myriapodes) commentée ainsi : « avec un s, il y en a deux ! » (mais la s est soulignée dix fois rageusement et les sclams semblent avoir débordé de la marge pour s’incruster dans le cuir du sous-main ou le vernis du bureau). On finirait presque par s’excuser en tartuffe : « totalement désolé, c’est sans doute un calque de l’anglais on foot qui m’aura induit en cette grossière erreur. ». Mieux vaut-il, en effet, perdre le client quand il s’entendra dire que son service de correction est nul du fait d’avoir laissé passer une s superflue ou tout de suite, en osant le contredire et avoir l’outrecuidance de mettre ainsi en doute son excellence ? Allons-y pour la marche (orthotypographique, car on parle d’une marche maison pour les conventions propres à une maison d’édition) à pieds ! Sanctionnée, ointe, par le sceau de Genève s’il le faut !
Le client a d’ailleurs, finalement, toujours raison. Entrez donc « marche à pied » en tant que requête Google, puis « marche à pieds ». La forme fautive l’emporte. Et bientôt, les 2 610 000 occurrences de « walk on foot » céderont devant la montée en puissance des quelque 227 000 formes fautives, « walk on feet ». Pour le français, l’« excellence » l’a déjà emporté ; « marche à pied » contre « marche à pieds » : 175 000 à 223 000… mais la requête marche+à+pied, sans guillemets, avec 4 550 000 contre 9 650 000 pour marche+à+pieds, est trompeuse : Google a « corrigé de lui-même » et les instances de la forme « à pied » sont inclues – ou incluses – dans ce « petit milliard » de résultats. Le client n’ira pas douter de lui-même, la correctrice ou le correcteur angoissé s’abstiendra de relever que la marche « à pieds » de Google comporte une formidable proportion de pieds singuliers ; seraient-ce les sabots du démon de l’excellence ?
Les correctrices et correcteurs de France métropolitaine seront sans doute bien étonnés de lire, dans le Trait d’Union, que l’Arci considère qu’à la correction de mille signes se doit d’être facturée quatre francs suisses ou 2,64 euros. Cela, espaces incluses, ou inclues, puisque, désormais, le correcteur orthographique de MSWord 2007 (peut-être encore d’origine Cordial « allégé », de Synapse, concurrent, pour les texteurs de ProLexis, de Diagonal), accepte les deux formes. La correction, en France métropolitaine, relève désormais davantage du savoir survivre que du savoir-vivre. Ce tarif de l’Arci se fonde (et non « se base », forme encore fautive, mais tout dépend ce qu’inclut votre marche d’édition) sur un tarif horaire de 60 francs suisses pour des textes corrigibles au rythme de lecture angoissée de 15 000 signes par heure. Soit près de 40 euros de ou à l’heure. Plus de quatre fois ce que des bac+5 survivant de la correction de ce côté du Léman (ou lac de Genève) facturent généralement, hélas.
Ce n’est pas tout. Car le tarif aux mille signes peut faire l’objet d’une « échelle de complexité ». Et l’Arci de citer divers exemples pour, par exemple, une « réimpression » ou un « texte particulièrement bien écrit » (réduction de 10 %), ou des textes comportant de nombreuses disparités nécessitant autant de vérifications en vue d’une uniformisation (pour toute et chaque « inclus » ou « incluse » faire…, si le tapuscrit est un fichier informatique), ou encore de nombreux termes scientifiques ou du jargon technique, beaucoup de notes, ce qui entraîne des majorations jusqu’à 20 %. Un tarif dégressif s’applique pour les travaux récurrents ou de fort(s) volume(s), les travaux en urgence (écrire : tarif rush, cela impressionne mieux le client), de nuit, &c. Bien évidemment, une réduction de près d’un tiers peut s’appliquer pour des travaux « en secondes » (lectures en pages montées) « si le bon à composer a été établi par nos soins ou si cette lecture suite une première lecture faite par nos soins, » précise-t-on, en jargon. Le BAC précède ici le BAT (bon à tirer, et non brevet d’activités techniques). Ce tarif actualisé correspond en fait à une majoration de cinq francs suisses de l’heure par rapport à celui de l’année 2000 pour des rythmes de « 12 000 signes à l’heure pour la lecture avec copie, et de 15 000 signes à l’heure pour la lecture sans copie pour les travaux courants. ».
Mais cessons de jargonner pour revenir au sommaire du Trait d’Union qui, pour le centenaire de la naissance de Léo Malet, père de Nestor Burma, remémore que ce dernier tenta en vain de devenir correcteur et préféra aller vendre des journaux à la criée. Cela nous fait au moins un point commun : j’ai vendu The Black Dwarf, The International Times et Le Monde à la criée. Ainsi qu’Uss’m Follik, bien évidemment, pour lequel je composais mes propres articles sans toujours trouver un confrère pour les relire et les corriger. Dès lors, il ne me reste plus qu’à écrire des polars ou des noirs. Vaste programme. L’article sur Léo Malet, nous indique Roger Chatelain, est un extrait d’un autre, à paraître dans la Revue suisse de l’imprimerie (Typografische Monatsblätter – Swiss Typographic Magazine). Avis aux amis de l’Association 813, ceux des littératures policières. André Panchaud évoque pour sa part les nègres littéraires. Pour l’avoir été et aussi adapté vers le français la prose d’un ghostwriter, cela nous fait deux points communs. En lisant Marinette Mathay évoquer le futur Observatoire linguistique (de et en Suisse romande), je me retrouve tout aussi Homais que lors de mes nuits passées à Porrentruy. Et j’en omets (avec une s que le correcteur intégré au texteur ne décela qu’après un temps de latence alors que ProLexis vous le repéra en une fraction de seconde), de ces courts textes passionnants (sur l’incertain futur du verbe gésir, sur le bouchon qui ne doit pas être confondu avec un encadré, sur les jeunes à jeun ne jeûnant guère et pratiquant la soule orthographique tout leur saoul : non, là, j’invente, mais si peu…) qui font tout l’intérêt du Trait. Mais passons à la ligne.
Pour mettre un point final : je cesse de tirer à la ligne à propos du Trait. Et je vais, plus tard, traiter d’autre chose, par exemple du site d’Albert Boton, et de ses kakebotons. Mais tiens donc, c’est peut-être un sujet d’article pour un futur Trait d’Union…
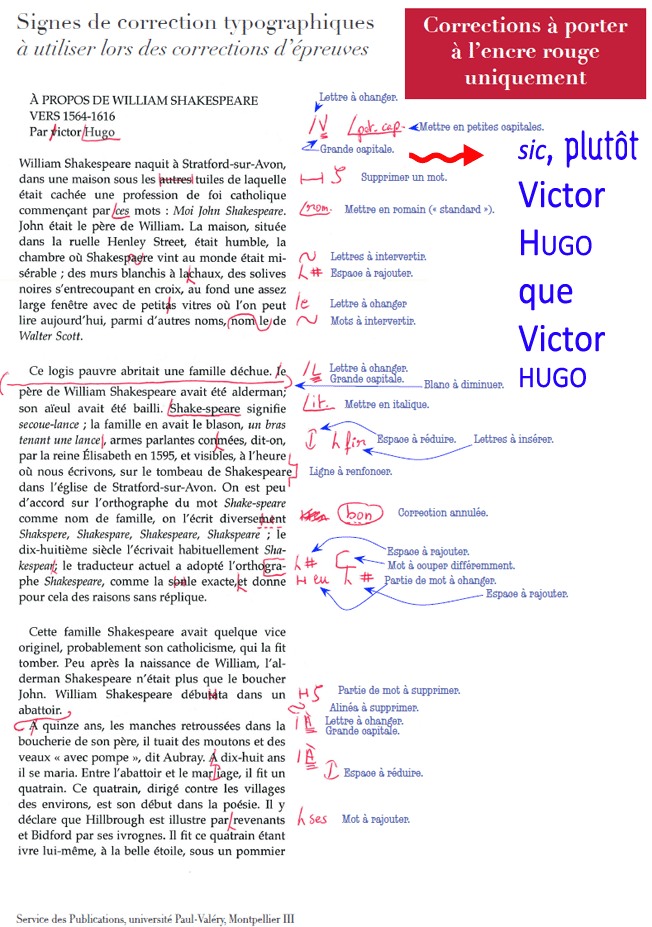
[b]Jef[/b],
Étant calé en orthographe, cette méthode de correction m’intéresse vraiment…
C’est ce dont à quoi je m’amusais lorsque mes camarades me demandaient de corriger leurs fautes d’orthographe ou même d’espacement quand on travaillait sur les ordinateurs 😉
Bref, ce ne sont que de simples détails mais votre article est fort intéressant en tout cas !
[b]
Amitiés,
Benjamin[/b]
Merci Benjamin.
Pour Humaniste : consulter l’article de Sophie Brissaud… Toutes les parutions des [i]Cahiers GUTenberg[/i] sont en ligne.
Pour un peu expliciter certaines choses…
La correction est à la fois orthographique, grammaticale, typographique et doit porter aussi sur le fond. Pour l’orthotypographie, c’est à la fois une discipline en siences humaines et sciences du langage (voir l’article de Wikipedia dont je suis l’auteur initial) et une pratique.
S’astreindre à relire de manière professionnelle, un peu comme les dactylos qui recopient sans s’attacher au sens mais à la forme (pratiquement en épelant chaque lettre en leur for intérieur), c’est franchement fastidieux. Mais quand on est formé à et payé pour, on le fait, en sus du reste…
Cependant, comme vous l’avez dit, il s’agit d’une discipline de moins en moins pratiquée, généralement mal perçue et souvent mal rémunérée…
[b]Dommage, il y en a pourtant besoin ![/b]
Je viens de me rendre compte que j’ai inversé, je voulais bien évidemment dire : [i]souvent mal perçue et généralement mal rémunérée…[/i] 😉
…
@ Jef.
Merci pour vos explications et cet article.
A plus sur la fréquence.
Bonne fin de soirée,bye.
Bonjour !
Je me suis régalée en lisant votre article, et, comme vous, je trouve dommage de faire l’impasse sur les correcteurs ; surtout à cette époque où les jeunes ne savent plus lire ni écrire (peut-être est-ce la raison de cette non correction ?).
Quoi qu’il en soit, outre les mauvaises traductions, nous voyons de plus en plus de fautes de français dans les romans et les écrits, sans parler des erreurs typographiques qui ne sont même plus relevées.
Je travaillais comme graphiste, et voir passer tous ces textes non corrigés me hérissait.
J’ai eu la chance de travailler un temps dans une imprimerie qui venait d’être rachetée, qui avait encore une correctrice. Elle fut licenciée (tout comme moi d’ailleurs, j’étais trop perfectionniste certainement, si on considère comme perfection de ne pas envoyer des documents imprimés avec des manques ou autres coquilles…)
Reviendrons-nous un jour à un français bien écrit ?
Voir apparaître des fautes telles que deux verbes conjugués l’un à la suite de l’autre a tendance à me hérisser.
Par contre, je ne connais pas les logiciels dont vous parler pour la correction orthographique, mais je vais de ce pas me renseigner. Je suis vivement intéressée.
Merci.
Chère Nairo, Chère collègue,
Dans la mesure où je me suis intéressé de près au graphisme (avec les revues [i]Pixel[/i] et [i]Création numérique[/i], puis [i]Créanum[/i], que je réalisais en partie), permettez le « collègue ».
Effectivement, avec le « comme » qui devrait être très souvent voué à la gomme, et le « suite à » sans avenir, la forme fautive infinitif suivi d’infinitif lorsque le participe passé s’impose est l’une des plus récurrente dans la presse. Elle est vénièle en ce sens qu’il s’agit d’un lapsus de saisie et non d’une méconnaissance de la langue.
Pour les logiciels. J’ai été formé au traitement automatique du langage mais c’est déjà loin derrière moi. Il y avait, antan, au Québec, Hugo Plus. J’imagine que Correcteur 101 existe toujours. Cordial (un bordelais, celui-là), est l’un des plus connus des français. C’est le québécois Antidote qui a le plus, actuellement, la cote.
Cela étant, l’intérêt de ProLexis est de s’enter (se enter ? c’est en tout cas un vb. tr.) sur les deux principaux logiciels de PAO, QuarkXPress et Adobe InDesign. ProLexis donne d’ailleurs le choix, pour l’orthotypo, entre les marches Imprimerie nationale SA (la défunte I.N. de France, soit le [i]Lexique[/i]) et Arci ([i]Guide du typographe[/i], ex-Guide du typographe romand).
Actuellement, je considère que le [i]Guide[/i] ex-romand et le [i]Ramat[/i] de la typographie (franco-québécois) sont les plus recommandables.
Mais tentez la rechercher Lacroux+Hurtig+Orthotypographie devrait vous conduire à une source des plus intéressantes en la matière.
[url]http://www.orthotypographie.fr/index.html[/url]
C’est vraiment dommage que la profession de correcteur soit si mal perçue. En fait, dans le cas de la presse ou dans toute communication écrite, des normes grammaticales, orthographiques et typographiques sont imposées non seulement pour mettre en valeur le sujet de la communication mais aussi pour en transmettre le sens de la manière la moins altérée possible.
[http://fr.lingo24.com/]Lingo24[fr.lingo24.com]
Depuis la mise en ligne de cet article, j’ai reçu la toute dernière (ou toute première, c’est selon) édition du [i]Ramat de la typographie[/i]. Aurel Ramat s’est adjoint un coauteur, Romain Muller, et le titre et le diffuseur changent.
Il s’agit désormais du [i]Ramat européen de la typographie[/i].
À l’heure où la fessée est menacée d’être « frappée » d’interdiction, la correction, fût-elle orthographique, peut craindre pour son avenir.