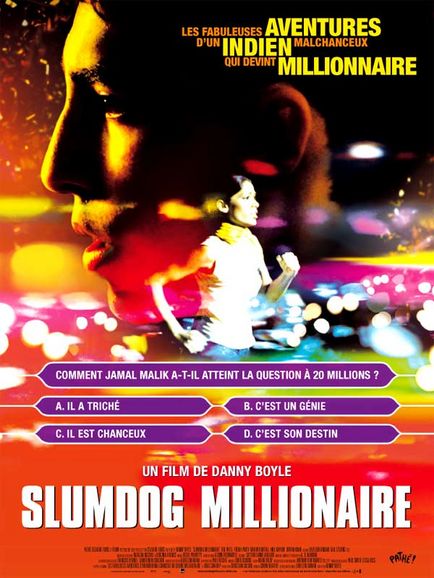Grandir est un mouvement. Une idée magnifiquement mise en scène par Gus Van Sant dans son nouveau film.
Si j’étais un critique sérieux, j’aurais lu le livre de Blake Nelson dont est tiré le film et me serais livré à une analyse comparée de derrière les fagots (from behind the fagots en anglais) où j’aurais défini dans quelle mesure le film s’affranchissait du livre et/ou en respectait l’essence.
Comme l’écrivait une de mes consœurs : « Les dialogues naturels et la simplicité du style de Nelson créent un héros touchant et gauche dont la vulnérabilité adolescente et la morne dérive évoquent sans éclat factice les universels errements de cet âge (Agnès Leglise, Rock&Folk N° 483)
C’est vrai sauf pour la morne dérive mais on va y revenir.
Si j’étais un critique sérieux, j’aurais à nouveau visionné Elephant, Gerry et Last Days et aurait conclu, illuminé par l’évolution de l’œuvre : « Paranoid Park ne serait ni un film de transition, ni un supplément gratuit à la trilogie, mais le dernier moment, l’apothéose d’une tétralogie. Apothéose en mineur quant au sujet, en majeur quant à l’emploi souverain des formes expérimentées dans les trois premiers films (Cyril Neyrat, Cahiers du Cinéma N° 627) comme mon autre honorable confrère.
Mais comme je rédige mes critiques en dilettante même pas payé à coups de pied au cul (ça serait une forme de reconnaissance), je vais me contenter de vous dire ce que j’ai pensé de « Paranoid Park » vu à froid et si vous êtes sages, je vous dirais peut être si c’est bien.
Devenir un homme.
Tout simplement.
Voilà pour moi de quoi parle essentiellement le film de Gus Van Sant et pourquoi je réfute le terme de « morne dérive ». L’histoire d’Alex est plutôt l’histoire d’un envol. D’un envol vers le monde des adultes, celui du mouvement.
Car au début, Alex est un enfant, enfin un adolescent qui regarde le monde s’agiter autour de lui au ralenti. Que ce soit les évolutions des skaters de Paranoid Park, les questions de l’inspecteur chargé d’enquêter sur un crime, le visage des filles au centre commercial ou la colère de sa copine, Alex regarde d’un air perplexe et détaché le monde en tant que spectateur. Mon adolescence est suffisamment proche pour que je me rappelle (ou croie me rappeler) qu’à cette époque tout semblait se dérouler plus lentement, avec une exubérante et paisible lenteur. Peut être tout simplement parce que je n’étais pas impliqué dans les événements. Je n’étais moi aussi qu’un spectateur, détaché d’une existence où les décisions étaient prises à ma place.
D’ailleurs jusqu’à l’accident fatidique, Alex n’est lui aussi qu’un spectateur : il se contente de regarder les autres faire du skate et préfère subir la provocation que de se lancer. De même, c’est sans conviction qu’il couche pour la première fois avec sa copine avec cette idée toujours suggérée par la mise en scène qu’il est absent à lui-même (d’ailleurs comme il l’avouera par la suite avant de se rétracter : « ce n’était pas son idée »)
Mais Gus Van Sant nous rappelle que ce corps immobile à la placidité angélique est chargé d’une promesse de mouvement, d’une liberté lors de ces scènes magnifiques où Alex arpente au ralenti les couloirs de son lycée ou un chemin serpentant entre les dunes au son d’une musique aérienne.
Alex va bientôt rentrer dans le mouvement.
« Personne n’est jamais prêt pour Paranoid Park ». Jared, le meilleur ami l’a averti. On ne choisit pas de grandir. Cela s’impose à nous.
Pour Alex, l’élément déclencheur sera cet accident tragique au cours duquel il cause la mort d’un vigile par ce qui est le premier mouvement voulu du film, un coup de planche de skateboard.
Dès lors, la machine est lancée et le premier mouvement sera la reptation gore de la victime incrédule.
Mais ce n’est que le début. Pour que la transition soit complète, il faudra qu’Alex se réapproprie son propre mouvement par la création (suggérée par une femme ce qui permet à GVS de redonner de l’importance à une figure féminine). D’où cette répétition de certaines scènes clés dans lesquelles Alex se réapproprie par la narration la parole qu’il avait subi.
Tout se terminera par un feu de joie et par des images de skaters anonymes faisant de la ville leur terrain de jeu. GVS va jusqu’au bout de son idée : le mouvement brut s’est affranchi de la narration même du film. Plaisir du mouvement pour le mouvement.
La vie, enfin.
Le premier plan montre les voitures défilant en accéléré sur le pont de Portland. Il pourrait s’agir paradoxalement de la seule image adulte du film. Pour le reste : éloge du mouvement, promesse du mouvement, accomplissement du mouvement, Gus Van Sant montre à travers Alex que le passage à l’âge adulte est une histoire d’inscription du corps dans différents rapports à la mobilité et utilise avec beaucoup de finesse le contraste entre le déplacement permanent du monde du skate et la pesanteur des banlieues paisibles américaines pour illustrer son propos ainsi que placer Alex à la charnière de ces deux mondes. Une définition parfaite de l’adolescence.
C’est d’une part pour l’extrême délicatesse, la maîtrise et l’intelligence avec lesquelles tout cela est mis en scène mais aussi pour ces moments fugaces de complicité entre Alex et Macy, cette scène pudique entre Alex et son père, cette restitution de l’insouciance des teenagers et ce ballet de skaters rythmé par une musique planante et expérimentale que « Paranoid Park » est un film magnifique et remarquable.
Un film idéal pour tous ceux qui ne confondent pas vitesse et précipitation et qui savent apprécier la lenteur pour la simple beauté du mouvement. Un film pour tous ceux qui n’ont pas peur de et savent encore prendre leur temps.
Retrouvez tous les articles de Stanislas sur: www.du-cote-de-chez-stan.com