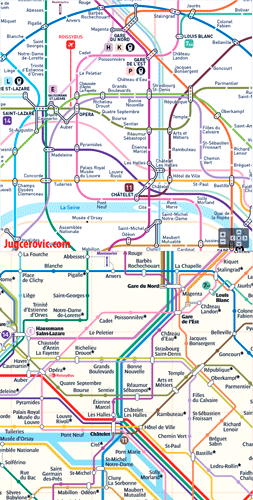Reed Brody n’est assurément pas un homme comme les autres. Pourquoi ? On le surnomme le “chasseur de dictateurs”. Porte-parole de Human Rights Watch (HRW), il a traqué des années durant Hissène Habré, ancien dictateur tchadien. Pour le troisième jour du 6ème festival du film sur les droits humains, la moitié de la journée lui a été directement ou indirectement consacrée. Deux films ont ainsi été proposés, suivis de débats.
Le premier film, qui lui est nommément consacré, the dictator hunter, a un côté hollywoodien dérangeant. Assez peu de place est donnée aux victimes de Habré, et Brody y fait l’objet d’un culte quelque peu dérangeant pour un homme qui se veut avant tout un outil actionné par la défense. On y découvre comment il a mis sa vie personnelle de côté des années durant et quelle souffrance anime les victimes et leurs proches de cette dictature longue de 8 ans (de 1982 à 1990). Un travail de longue haleine, qu’il poursuit malgré les déconvenues uniquement pour éviter l’oubli. Car depuis plusieurs années, l’ancien président a trouvé refuge au Sénégal, dans une confortable villa d’où il peut toiser sans remords ses anciens citoyens venus lui demander de rendre des comptes.
Comme l’explique Brady, “tuez une personne, et vous êtes accusé de meurtre. Tuez-en 40, et vous êtes interné dans un asile. Déchaînez la violence et assassinez-en 40′000, et vous voilà à l’abri de représailles”. Jusqu’à Brady, aucun ancien dirigeant africain n’avait été traduit en justice. L’impunité des crimes dictatoriaux semble totale; le seul dirigeant qui aurait pu faire l’objet d’une accusation, Slobodan Milosevic, est mort dans les geôles de La Haye. Le courage de cet homme pourrait faire basculer cette coutume : l’Union africaine (UA) a décidé, il y a un an et demi, sous la pression des activistes des droits de l’homme de juger son ancien membre au Sénégal. Au Tchad, le procès n’aurait pu avoir lieu. Et établir le tribunal en Belgique, pays d’où a été activée la procédure à l’origine, serait politiquement problématique, puisque les dirigeants africains actuels ont le sentiment qu’il s’agit d’une affaire africaine. On préfère laver le linge sale en famille.
Malgré cette fantastique réussite, Hissène Habré n’a pas été jugé en 18 mois. L’instruction n’a même pas démarrée. Des signaux contradictoires sont émis pas ceux-là même qu’hier, s’engageaient personnellement à faire triompher la justice. Idriss Déby, “président” depuis sa chute, perçoit le risque qu’il peut y avoir à demander aux dictateurs répondre de leurs actes. Et c’est là le coeur du problème : comment juger un dictateur, sur un continent où la démocratie est un voeux pieu ?
Le second film projeté, Uganda rising, traite de la guerre civile ugandaise. Une guerre peu médiatisée, et qui pourtant n’a d’égal dans sa sauvagerie que le conflit du Sierra Leone. La logique des enfants soldats, fléau de l’Afrique, y est exposée dans toute son horreur. Comment juger des enfants, embarqués contre leur volonté, forcés à tuer leur famille sous peine d’être eux-mêmes exécutés ? En admettant que la paix s’impose, que faire d’adolescents au parcours déconnecté de toute notion de bien ou de mal, qui ont tout perdu et déjà commis ce dont une âme ne saurait oublier ? Les réponses ne sont pas évidentes. Surtout que le petit pays, voisin du tristement célèbre Rwanda, n’est pas pacifié; aujourd’hui encore, des camps insalubres font office de refuges pour des dizaines de milliers d’individus. La jeunesse, souvent orpheline, n’a d’autre choix que de marcher une fois le soir venu, afin d’éviter d’être embrigadée dans les troupes de la mort menées par la Lord’s Resistance Army (LRA) de l’illuminé Tito Okello. La marche, dans l’est de l’Afrique, est un acte banal; mais on n’avait jamais vu des villages entiers d’enfants être amenés à se déplacer de nuit, fuyant la guérilla et le risque d’être transformé en assassin.
Le cas de l’Ouganda, outre son visage monstrueux, pose encore une fois l’opposition qu’il peut y avoir entre justice et paix. Yoweri Museveni, “président” du pays, après avoir fait appel à la Cour pénale internationale (CPI), s’est ravisé ces tous derniers jours : il serait sur le point de conclure un accord avec la LRA, et a demandé la CPI de suspendre l’acte d’accusation à l’encontre d’Okello. Choix discutable, mais est-il si erroné ? Museveni, cité autrefois par le président Clinton comme “dirigeant exemplaire”, est un dictateur. Peut-être pas le plus sanguinaire, surtout selon les critères africains, mais un leader illégitime malgré tout. Ce dictateur saisit la CPI; la Cour doit-elle se contenter de juger la LRA, qui viole (au moins) l’interdiction du crime de guerre, ou doit-elle se pencher aussi sur les exactions de l’armée officielle de Museveni ? En quête de légitimité, Ocampo, le procureur de la Cour, a choisi de faire l’impasse sur ces derniers crimes. Est-ce un tort, sachant que de légitimer la CPI pourrait lui permettre de se réclamer comme un interlocuteur valide dans le futur, et pouvoir avoir la chance de poursuivre une quantité plus de criminels ? Savoir s’il faut poursuivre l’instruction de la LRA et se pencher sur les abus de Museveni, ce n’est pas une mince affaire. Il ne fait nul doute que dispenser la justice en Ouganda n’est pas une mince affaire.
Le travail d’ONG telles que HRW est ambitieux, presque téméraire : il n’existe rien d’établit dans le domaine, poursuivre les criminels de masse est une nouveauté de la fin du XXème siècle. Poursuivre les leaders sanguinaires revient à demander à la communauté internationale d’inventer de nouvelles procédures. Et surtout, c’est demander aux dirigeants de remettre en question leur toute-puissance, et par-là même perdre une partie de leur souveraineté : ils sont redevables envers l’humanité des atrocités commises. La fin de l’omnipotence n’est cependant par prévue dans l’immédiat; la communauté internationale, Union européenne mise à part, continue à jalousement défendre ses droits régaliens, et le président de l’Etat le plus puissant de la planète, George W. Bush, défend bec et ongles le droit à la torture; dans ces circonstances, peut-on vraiment croire que les USA auraient intérêt à accepter la compétence de la CPI, lequel serait, en cas d’adhésion des Etats-Unis à l’organisme judicaire, habilitée à en poursuivre ses dirigeants ?
On le voit, il n’y pas de réponse toute faite. Les conflits sont tous différents, avec des acteurs et méfaits propres à un pays, à une époque donnés. Les solutions doivent être adaptées, et si la “justice transitionnelle”, inspirée par l’expérience de réconciliation d’Afrique du Sud, a le vent en poupe, elle n’est pas pour autant la panacée. Au fil des épreuves, des avancées significatives voient le jour; mais cet apprentissage est chèrement payé, avec le sang. Combien de famille détruites, de destins brisés, on ne saurait les compter sans être sujet au vertige. L’histoire jugera de nos hésitations, et elle s’est rarement montrée clémente.