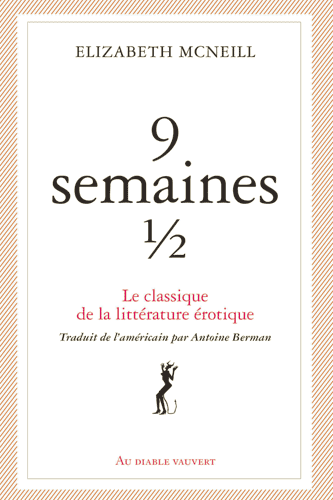Très peu lu en France, car jusque là non traduit, le livre ayant été (plutôt mal) porté à l’écran sous le titre 9 semaines ½ est l’œuvre d’une Autrichienne naturalisée étasunienne peu avant 1960, Ingeborg Day. Son pseudonyme d’Elizabeth McNeill avait été « percé » et même si elle n’a jamais revendiqué cette identité, son récit quasi « naturaliste » peut assurément lui être attribué. Le Diable Vauvert diffusera cette traduction française début novembre prochain.
Nommons-la Béa (elle, je), appelons-le Abe (il, lui). C’est plus facile que d’itérer « la narratrice », et « l’autre principal protagoniste » (l’amant). Béa serait à la fois auteure, sous son alias d’Elizabeth McNeill, et son personnage qui ne serait autre qu’Ingeborg, épouse Dennis Day, Autrichienne d’une trentaine d’années vivant aux États-Unis depuis l’âge de 17 ans, née Inge Seiler en 1940, décédée par autolyse en 2011 (à 70 ans, et physiquement malade, tout comme son second mari).
Abe rencontre Béa fortuitement, et en deux-trois nuits, il parvient à lui faire ressentir des orgasmes mémorables.
Béa est loin d’être sotte, car cultivée, rôdée par des voyages à l’étranger, un job pas trop insignifiant, mais elle reste plutôt girly (consulte son horoscope, décore sa chambre en quasi-bonbonnière, se refuse peut-être à regret de dévorer des romans-photos) et bobo avant l’heure. Abe est le yuppie parfait, un poil austère, maîtrisant des langues étrangères, discret dandy, appréciant le chablis, d’âge en rapport avec celui de Béa ; il entretient trois chats dans une indifférence réciproque.
Très vite (quatrième, cinquième nuit ?), il la frappe – deux gifles sèches au visage – pour la marquer. « Ainsi progressèrent les choses : pas à pas ». Cohabitation semblant aller de soi. Premiers coups furtifs, rares, espacés (cravache, peigne…). Acceptés, de fait, et non sollicités, ni négociés. Abe joue de Béa : c’est sa Barbie à lui ; qu’il lustre et pare. Qu’il attache et bâillonne. Garde menottée.
Trois semaines après la toute première rencontre, les rites sont ancrés dans le quotidien. L’appartement, celui d’Abe, est devenu insulaire : très peu de sorties ; huis clos. « Zébrée de coups » mais toujours plus désirante. « Tu n’as pas l’air de comprendre ce qui se passe entre nous », commente Abe. Bizarrement, Béa ne recherche pas de références, elle se sent « prête à tout pour lui » et pour la suite, elle ne la cherche pas dans des livres. Pourtant, elle pourrait relire Histoire d’O, lecture obligée de générations successives de jeunes filles des classes moyennes, supérieures, ou autres, plus curieuses ou plus suiveuses.
La période de confinement a porté ses fruits, Béa peut de nouveau être sortie en ville. Une phase fétichiste s’ensuit : Béa se fait, sur ordre, garçonne, et bien sûr sodomisée. Puis, escarpins de fille de claque (n’oublions pas l’époque : c’était alors réservé aux magasins spécialisés), dessous soyeux. Un mien cousin confectionnait lui-même escarpins ou bottines ; c’était un fasciné par les bas coutures, souvenir d’escalier et de jolie jeune prof de collège. La giarrettiera rosa, chante Paolo Conte, chi la vede non la scorda piu. Cela étant, poursuivons la digression, les calbuts Petit Bateau, sur croupe féminine adaptée, ce n’est pas mal non plus… Abe en convient, mais ne connaît que le « coton blanc de chez Woolworth ».
Si je meuble, c’est que je poursuis la progression du récit et que, là, l’épisode des (très) hauts talons, bof… D’un autre côté, c’est cela qui rend – un peu, avouons, beaucoup – cette narration fascinante : la banalité du quotidien rompue par des initiatives ou apports certes imaginatifs, mais finalement convenus, du genre BDSM et fétish. Cela se lit à deux mains, à moins, bien sûr, d’être prépubère, ou de découvrir totalement ce type de littérature. J’imagine que les adeptes seront davantage sensible à la progression des exigences du dominateur et de l’abandon de la soumise. Laquelle ne rechigne pas pour s’épargner l’humiliation de marcher à quatre pattes, lombes redressées, mais tout à coup, se sent ridicule. « Quand je voudrai me moquer de toi, je te le dirai », réplique Abe, qui menace d’expulser Béa de sa vie bien davantage que de la dérouiller de nouveau à la cravache. Elle plie pourtant, une fois de plus, pas encore de trop. Découvre que les punitions ne sont pas seulement la condition du dressage, mais une rétribution de qui les inflige et se repaît d’en contempler ou entendre les effets. Même s’il ne les administre pas lui-même et rétribue un comparse pour contempler son « œuvre » (ma libre interprétation, ici).
De jour, Béa tient son rôle de supérieure ou subalterne, de collègue, de copine, de travailleuse intellectuelle ; de soirée et de nuit, elle ne décide plus rien : « j’étais là non pour faire, mais pour “être faite” (…) j’avais en revanche la permission de perdre tout contrôle », résume-t-elle. Sujétion, abdication confortable, apaisante.
Même quand l’épreuve consiste à se transformer en gagneuse lourdement fardée, dans un hôtel de passe crasseux, en compagnie d’une « copine » inconnue, vraie professionnelle, qui assure la première passe, la révolte sera courte.
« Je me demande jusqu’où nous pouvons aller », s’interroge(nt)-t… illes ? comme l’écrirait Anne Larue ? Enfin, c’est Abe qui parle, ou McNiell-Day qui lui attribue cette phrase, mais l’interrogation s’impose aux deux amants. L’emphase porte sur le «jusqu’où ». Je l’aurais fait porter sur le « nous ». Béa répondra par la fuite : au bout de neuf semaines et demi, son corps, son cerveau, disent stop, c’est trop. Suit un semestre de traitement et convalescence loin de tout, auquel Abe abandonne Béa.
On peut dévoiler la fin, la dernière phrase : « des années ont passé, et je me demande parfois si mon corps pourra jamais enregistrer autre chose que des sensations tièdes et moyennes ». Renoncement de revivre la soumission, refus de passer dominatrice : et le trop mièvre aura peut-être eu raison d’Ingeborg Day, à 70 ans. À moins que ce ne soit le passé familial en Autriche, un fils mort en jeune âge, ou, allez savoir, une imposture ou une autre (en tout cas, à ses propres yeux), tout autre chose encore ou en sus…
Le Diable Vauvert n’a pas conservé le sous-titre « Mémoire d’une affaire d’amour » (ou mémento, comme on voudra), préférant caser en couverture ce « le classique de la littérature érotique ». Érotique, ah, bon, vraiment ? Pour que Neuf semaines et demi s’apparente vraiment au genre érotique, peut-être faut-il rechercher des photos de l’auteure (on en trouve, à divers âges), ou s’imaginer un, une partenaire. Hormis quelques phrases crues, tout aussi factuelles que les descriptions des décors, ou que l’enchaînement des liens et phases progressives et transgressives, ce qui tient le lecteur (et sans doute la lectrice), c’est une voix. Qui est celle, transcrite, d’une déposition non expurgée par la maladresse d’une ou d’un fonctionnaire de police pas trop familiarisé avec les claviers. Puis, avec le tout dernier chapitre, une haletante confession étayée rétrospectivement d’un comparatif entre ébats et relations antérieures, plus anciennes, remémorées, et cette récente liaison si particulière…
La célèbre transposition à l’écran (avec Rourke et Bassinger) a sauté quelques épisodes, en rajouté au moins un autre, dénaturé certains éléments, et presque totalement évacué le côté clinique du livre.
Lequel fait davantage songer, par extension de situations, tonalités aussi, à Portier de nuit (1974, de Liliana Cavani, avec Charlotte Rampling) que, finalement, au film d’Adrian Lyne.
Day, embarrassée, l’avait qualifié d’erotic epic poem. Enfin, histoire de résumer. On peut effectivement l’énoncer ainsi, circa 1977. Elle travaillait alors dans un magazine d’un féminisme plus proche de celui d’Elle que de Cosmopolitan. Donner dans le SM faisait tache.
Il peut être valablement supputé qu’Elizabeth, Seiler-Day, et « Béa » aient été une seule et même personne. Quoique… Le SM était déjà documenté, Seiler-Day savait amplement se documenter, et peut-être s’agit-il d’une fable. À potentialité documentaire, même si l’univers SM est beaucoup plus diversifié, que les rôles y sont parfois interchangeables (dominant·e/dominé·e), davantage – ou non – régi par le simulacre et l’artifice, voire proche du simple décoratif. Prendre McNeill à la lettre est peut-être tout aussi niais que d’imaginer que toute fiction est absente du Vanina Hesse d’Alain (Georges) Leduc (La Musardine éd.). Mais l’auteure suggère fortement qu’elle se raconte vraiment : d’ailleurs, elle, enfin, Béa, écrit aussi d’autres histoires, dont celle « d’une femme qui [lui] a raconté qu’elle vivait avec un homme l’année où elle a écrit son premier livre. ». De plus, l’attention qu’elle, Béa, porte aux vêtements masculins est reflétée par le fait qu’Ingeborg s’habillait très sobre et puisait dans les rayons pour hommes des grands magasins.
L’une des originalités de ce Neuf semaines et demi est que le couple A. et B. s’énonce insulaire : les comparses ne sont pas de la tribu, mais simplement rétribués, vie sociale et vie privée se jouxtent sans jamais s’interpénétrer (et Béa, certes frappée par un tiers, ne sera jamais par aucun ou aucune autre pénétrée), que le prosélytisme reste totalement absent. La relation semble d’ailleurs totalement narcissique, bien plus que fusionnelle (les deux anagrammes imaginés ne se réunissent pas en monogramme) ; ce qui s’explique puisque si Abe s’exprime, rarement, tout est rapporté par Béa, qui décrit et ressent, se replonge dans souffrances et jouissances, très peu soucieuse de fait du plaisir de son partenaire qu’elle n’essaie pas vraiment de s’imaginer. Tout juste soupçonne-t-on qu’il tire son plaisir de la contemplation de celui de Béa, ou peut-être, de pouvoir surtout s’en glorifier… – de se sentir si bien faire jouir – sans qu’on puisse vraiment trancher. L’autre originalité, par rapport à d’autres récits qu’on classe trop rapidement « similaires », est que les protagonistes, qui ont d’autres types d’échanges (ils lisent, discutent, conversent à propos du quotidien sur un mode égalitaire), ne négocient aucun scénario. Rien ne se fait à l’initiative, même simplement discrètement suggérée, subtilement amenée, habilement réclamée, de Béa…
L’autre I. Day, c’est Ghost Waltz, Geisterwaltezer, bal d’ectoplasmes. Une autobio hélas peu prolixe sur ces Semaines. Par conséquent, l’auteure de ces deux livres, qui se confiait peu aux médias, reste énigmatique, en particulier sur cette période. Elle n’a jamais revendiqué les Semaines. Ni démenti ce qui sembla, semble toujours, flagrant.
Nine ½ Weeks a été traduit (par Antoine Berman ou le service commercial du Diable Vauvert) par 9 semaines ½ (comme, évidemment, l’affiche de la VF du film). L’édition originale comportait un titre « au long » (sans chiffres ni abréviation). Ce n’est pas plus mal : d’une certaine manière, la contraction rehausse la compacité de cette fort courte relation qui aurait peut-être pu se poursuivre si elle s’était étalée davantage, sans cette quasi marche forcée imposée à Béa, qui s’y prête, ne la casse mentalement… 64 ou 66 nuits, plus que jours, c’est presque un récit de bataille (hormis celle de Stalingrad, dépassant le semestre, peu durent guère plus longtemps), en huis clos, si chez soi, so domo, ou domus, home ou chapelle, et de rares excursions, ou incursions, raids, en autels hôteliers, pour des sacrifices délocalisés.
Or, l’étonnement provient de ce qu’il n’y a pas bataille. Pratiquement d’un instant à l’autre, le sujet Béa alimente le discours (ultérieur, de 2009) de Valérie Tasso qui confère à l’activité sexuelle un statut amoral (ou « démoralisé ») dépoussiéré du « discours normatif sur le sexe ». Lillith se laisse mater, (mal)mener ; et s’abandonne sans se poser vraiment des questions, préfigurant le « les normes ne sont pas implacables, mais bien celles ou ceux qui se les créent » de Tasso. Des réticences subsistent, mais résistent fort peu. Jusqu’à ce que, peut-être, le « discours » intériorisé reprenne le dessus, par un violent accès initial de dépression nerveuse, un coup de grisou paralysant.
Un peu moins de 200 pages, d’un style limpide, se lit aisément. Ce sera bien sûr perçu diversement selon l’étendue et la nature des lectures antérieures (ou des expériences et fréquentations). Mais il n’y a nulle apologie épique de la jouissance ou de la souffrance : l’auteure ne prêche pas, mais témoigne, sans fioritures.
Voici tout juste six ans, Le Diable Vauvert avait publié La Voie humide, de Coralie Trinh Thi, qui fut et reste proche de Virginie Despentes. Le temps n’est plus tout à fait aux maisons d’édition spécialisées (même si La Musardine, qui fait aussi dans la socio-sexologie, ou l’anthropologie, se porte plutôt bien). Harper Collins retirera les Semaines, cette fois attribuées à Day (plus qu’un retirage, une nouvelle édition, de ce seul fait). Le genre devient classique, pas moins prisé que peuvent l’être d’autres (dont la Science Fiction, par exemple). 9 semaines ½ y aura largement contribué… Mais si vous recherchez une lecture érotique, vous pourrez sans doute préférer Anaïs Nin à Day…