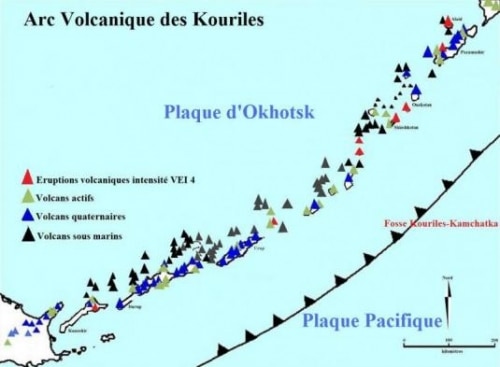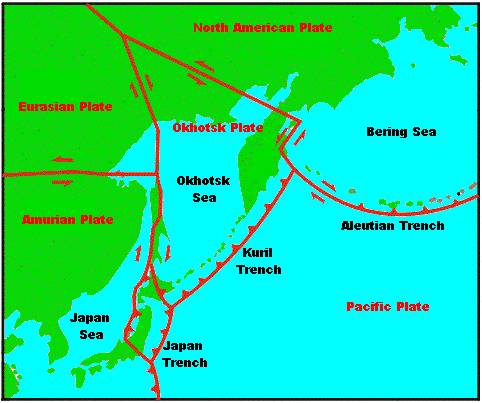Séisme de Seddon, Nouvelle Zélande, Magnitude 6.5, ni tsunami ni dégâts importants.
Le 21 Juillet 2013 à 05 h 09, Temps Universel, à 17 h 09, heure locale, un séisme de magnitude du moment, – Mw -, 6.6 pour le Centre Sismologique Euro-Mediterranéen, – CSEM -, de magnitude Mw 6.5 pour le GeoNet et...
Lire la suite