Ainsi donc, Bernardo, maître et amant de la fiancée de Zorro, Blanche Couette, formaient donc avec ce dernier, dans cette cave-donjon, le sublime trio d’une exquise « pâtion ». Du grand Liebig. Oui, mais de l’Étienne d’avant, comme dans ces publicités d’opticien avec des vedettes figurant des nez vieillissants, supports de montures de jouvence.
Là, cela fouette, petite jeunesse, tout autrement. Ce premier récit vrai – mais vrai roman – peut se lire fort sottement.
D’abords et d’issue faciles, il se boulotte ainsi tout autant, se referme sur un sourire, le même que celui avec lequel on le prêtera sans trop se soucier d’un retour, lui espérant un long parcours.
Mais l’anthropologie prescriptive ne laisse pas à l’infirmerie en chef de l’asile la mission de soigner les patients, appelés par elle à devenir leurs propres apothicaires.
Appréhendé intelligemment, ce traité d’anticipation, sous couvert d’un dual récit d’épée et de porte-plume croisés, se transmet – rieur – sous cape. Ne placer qu’entre les doigts de qui mérite l’initiation aux avenirs possibles éradicateurs du vieux monde.
Ce qui suit sera aussi à destination de ces libraires vendant – on peut le comprendre, survie oblige – à qui ne mérite pas de lire, ou lit trop court, trop mal. Ils trouveront de l’argumentaire de réclame. Concession aux masses desquelles un conte philosophique, même habilement dissimulé, comme ici par Liebig, tomberait des mains. Ce qui précède a été imaginé à partir de la seule lecture d’une quatrième de couverture, exercice divinatoire en valant d’autres, à coup sûr plus amusant. Si l’on commence à lire le bouquin, on va être porté à s’emm… et à lasser avec des considérations fumeuses.
 Comme quoi l’auteur éponyme, Étienne Liebig, est non point le narrateur homonyme (pour une fois, il aurait pu créer un Knor), soit l’anthropologue qu’il aurait pu mais refusé d’être, mais quand même beaucoup celui-ci, lequel utilise les méthodes d’investigation documentaire – et au plus près du vécu actuel du/des sujet/s – de l’auteur, pour tramer un récit historico-policier, sur deux périodes. Il procède à la Dumas entrelardé de Leblanc (Maurice, celui de l’Arsène Lupin, pas Elm Delorme), revisité par un G. Simenon paléontologue.
Comme quoi l’auteur éponyme, Étienne Liebig, est non point le narrateur homonyme (pour une fois, il aurait pu créer un Knor), soit l’anthropologue qu’il aurait pu mais refusé d’être, mais quand même beaucoup celui-ci, lequel utilise les méthodes d’investigation documentaire – et au plus près du vécu actuel du/des sujet/s – de l’auteur, pour tramer un récit historico-policier, sur deux périodes. Il procède à la Dumas entrelardé de Leblanc (Maurice, celui de l’Arsène Lupin, pas Elm Delorme), revisité par un G. Simenon paléontologue.
C’est du moins ce que je subodore.
Voici donc le réel premier roman du vrai Étienne Liebig dans sa véritable édition : Le Masque de Bernardo… chez Michalon.
Trichons un peu
Mais je consulte nonobstant illico la dédicace : « Jef, cette fois, pas de sexe, mais à bas le Masque&nbps;». Menteur. Pas de sexe ? Tu ne pourras t’en empêcher, il y en aura (eh, j’ai déjà feuilleté quelques pages au hasard). Mais c’est véridique : peu à voir avec les précédents Liebig. Rien de salace, de cru, juste du jouissif à mettre entre toutes les mains, même les préadolescentes.
Menteur deux fois, car c’est plutôt cette fois haut Le Masque, la collection des « whodunit », et si Liébig se réveille en arrachant son loup de redresseur d’idées tordues trop médiatiquement répandues, ou de mentor hédoniste (aux éds La Musardine), se révélant ici, enfin, vrai romancier au prétexte de ce Bernardo rendu par lui si réel, attesté par la documentation historique, dont le goutteux comparse Zorro tombe et la cape, et les bas de contention fourrés de martre, révélant un mankini outrageusement rembourré (oh, là, comment va-t-il me sortir de cette phrase ? se dit la lectrice égarée ; un peu de patience, diantre !), prouvant que mieux valait tard que jamais (faible, mais c’est fait). Liebig avait produit du romancé auparavant, c’est bien là son tout premier roman (avec peu d’ombre de parcimonieux morceaux de bravitude copulatoire dedans, ce qui, de fait, nous change).
La première phrase des remerciements (mention ultérieure du département d’anthropologie sociale de Paris-XIII) aurait gagné à être la troisième : « Pour la première fois de ma vie, j’ai connu le sentiment exaltant de l’aventure. ».
Merci, surtout, ô mânes de Bernardo, d’avoir si sentimentalement enchanté un Liebig baroudeur.
La première du premier chapitre aurait pu être celle de son troisième paragraphe, de la sorte : « Épuisé par la taraudante chiasse que me valaient les tacos al pastor, je me suis endormi assis, à point d’heure, bénissant le relatif confort d’une lunette, et me félicitant de n’avoir pas choisi de pister un héros anatolien sur ses arides terres. ».
Proustien, style fumet d’haricots, mais contemporain, quoi, à la manière de ces implacables abatteurs de récits haletants, formés, aiguisés par les writing worshops, genre Tom Corraghessan Boyle (un bestseller de l’an, mais n’ayant pas renoncé cependant à s’adresser à votre intelligence, même sous couvert de fabrique satisfaisant d’abord l’éditeur). Liebig fait preuve d’élégance en n’ayant pas (trop) recours aux subterfuges usuels, d’où ces premières phrases peu choc, mais qui caressent la lectrice, piquent progressivement sa curiosité qui ne restera pas alanguie, que nenni. Je ne dévoile pas ces préliminaires, vous savourerez.
Ah, ces chroniqueurs se prétendant littéraires, romanciers déçus, ou n’osant plus, si ce n’est jamais, qui devraient se contenter d’être bateleurs d’ouvrages ! S’interdire surtout de se mettre en avant. Je me repens. Je cesse de tricher, d’inventer éhonté. Je vais d’abord lire Le Masque de Bernardo (éds Michalon, 320 pages pour seulement 18 euros), et je vous reviens… derechef, pointe-bille en main et non en tête (à me curer, en panne d’inspiration foutraque, l’oreille), après l’intertitre.
Du suspense, du vivant, de l’humain !
Cessons ces titres convenus empruntés à la littérature ou au cinéma qui feraient que Liebig aurait même rencontré des Mexicains contemporains malheureux (petit rappel de son dernier essai sur les Rroms, aussi chez Michalon) et fait revivre des Californiens de naguère hilares, conviviaux, bon compères. Arrêtons de délayer le relevé bouillon cube de l’ouvrage dans le sirop fadasse de ses propres divagations. Halte aux tics, horripilants (surtout chez autrui et d’autres), qui masquent l’incapacité crasse d’apprécier (et le faire) réellement un ouvrage. Zut, cela m’a repris. Stop.
Deux récits imbriqués, donc. Initialement, celui de Liebig, Étienne, en quête, dans des bibliothèques, à Barcelone notamment, non plus de quoi alimenter une thèse sur De la chirurgicale construction-réception déstructuralainage-réparatrice des héros fictionnels, mais de Bernardo, puis au plus proche, au Mexique pré-étasunien, en fouilles archéologiques, là où se produisit, du temps survivant de Zorro, le terrible massacre du défilé des Trois Pierres noires, qui initia la réelle légende du Raposo (dit El Goupil andaluz).
En alternance, transportés sur les terres de l’hacienda d’Alenjandro de la Véga, nous revivons la palpitante reconstruction de l’épopée, avec des personnages inattendus, insoupçonnés jusqu’à présent, soit ante-Liebig, indios et autres, dont les infamies et exploits font encore frémir dans ma chaumière alors que les pages du Masque de Bernardo sont refermées.
Oui, « dans les années Houellebecq », les ados que nous restons lisent encore des romans d’aventure qui s’achèvent par l’espoir d’heureuse progéniture d’Henrique et de doña Esteban. Au passage, on en apprend de belles sur les mœurs universitaires : avis aux futures chômeresses et actuels précaireux procrastinés du boulot de par sa raréfaction — ce n’est pas de la tarte de chez Paul ou McDo que de se creuser un terrier universitaire suffisamment alimentaire.
La presse vous a évoqué ces jeunes et moins jeunes femmes violées et assassinées de frais au Mexique dont certaines sont de la lignée de celles marquées d’un « N » au cou, déliées ainsi de l’éternel – trop long d’expliquer ici pourquoi, faudrait se plonger dans les textes mayas –, dont les cadavres se retrouvaient, dans les années 1800, disloqués sur des autels du Jhesus catalan.
La médecine forte en sics, toisant les paillasses des allongées définitives, l’aurait consigné niaisement « Z », et entériné doctement le fallacieux mythe licite. Ce qui devait être initialement un Bernardo ou la mythologie de l’effacement vous les remémore au passage. Dans les pas d’Henrique Levii (devenu Bernardo), Liebig se fait Indiana Jones. Avec Alessandra ou Linda à ses basques ou réciproquement, Étienne traque le guineu (renard, en catalan) de part et d’autre de l’Atlantique.
Extrait :
« Il tue des Mexicaines en exil en Californie et à Barcelone comme son illustre prédécesseur. Alessandra est indienne, il le sait. Il va la tuer ! C’est même peut-être trop tard. ».
Oh, Ho ! m’exclamais-je en castillan, fissa, Liebig ! Cours, vole, la sauve et venge, accompagné de ton fidèle gurkha barcelonais Gutscha ; ce Moriarty déjanté n’osera pas impunément ! Putentrailles, ce fut d’un cheveu !
Attention, vnimanie, astarojna ! Jojo le Bouffi est juste derrière toi !
Faut meubler
Il est beaucoup plus facile de chroniquer du roman noir que du polar, pour lequel entrer dans les détails des péripéties déflore souvent autant le sujet que de dévoiler la fin (si elle n’est pas énoncée en tête de premier chapitre). Ce Bernado résiste, car même le sergent Garcia n’y est plus celui qu’on croit. Lever un coin du voile, ainsi narrer comment Henrique Levii devient Bernardo, exige une cauteleuse parcimonie. Trop ardu pour moi. Autant filer direct vers autre chose, cap sur ce « un roman (…) qui n’est pas sans rappeler l’humour grinçant de David Lodge », conclusion du prière d’insérer, qui permet de botter en touche.
David John Lodge (Londres, jan. 1935), universitaire déçu devenu écrivain à succès, révélé en France par l’excellente collection Rivages (dont Rivages noir), a aussi publié études, essais, ouvrages théoriques. D’où l’apparentement délocalisé d’un preste revers d’outre-Manche.
Mais il ne s’est jamais rôdé, comme Liebig, à la pochade (qui peut inciter à revisiter avec brio d’habiles facilités efficacement fonctionnelles), ni vraiment au terrain. Liebig, c’est sûr (d’autant que c’est un copain, sachant élégamment perdre au 4-21 pour ne pas laisser un fauché devoir payer la tournée), lui sera éminemment supérieur.
Je l’affirme avec d’autant plus d’aplomb que je n’ai pas encore lu Lodge, mais comme Gide, les yeux clos au fond d’un taxi, imaginait le paysage mieux que l’admiraient ses compagnons de voyage, je garantis la véracité inca de mon onirique prédiction.
Donc, si vous n’avez pas encore dévoré ce Masque de Bernardo (disponible en librairie courant octobre), foncez, aucune hésitation. Étonnez vos amis au comptoir et les Dugommier de vos dîners en ville, saluez avant tout le monde l’émergence d’un formidable écrivain. Jurez, aux avides extasiés, de prêter ce Bernardo en l’envoyant dès le lendemain par coursier (tous des voleurs, ou des fous du guidon, forcément grièvement accidentés avant de pouvoir délivrer le colis).
Surtout, n’en faites rien. C’est un volume de garde… qu’écris-je ? un col, un pic, un sommet, une cime de garde.
Ou snobez avec un énigmatique « je ne sais pas si c’est vraiment pour… » (toi/vous, décidément trop plouc). Vous en savez assez pour en évoquer, mine gourmande, la trame, depuis les fromages jusqu’au pousse-café. Vantez, énigmatique, un traité « visionnaire » pour esprits forts, tapi sous une intrigue à l’Umberto Eco.
Pour le reste, Wikipedia, avec ses fiches David Lodge et Étienne Liebig, devrait vous permettre de meubler la conversation.

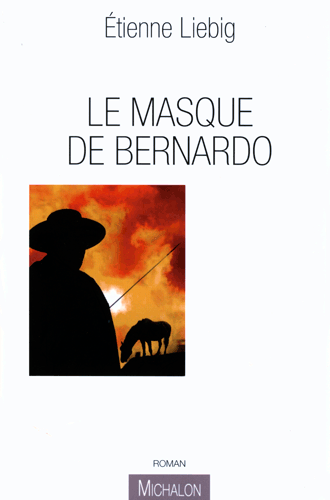


Initialement (par [i]Siné Mensuel[/i], auquel Liebig collabore) annoncé en vente le 25 octobre, ce [i]Masque de Bernardo[/i], selon Maud Prangey, de Michalon, serait sur les tables dès le 18 prochain.
Pour faire semblant de l’avoir lu auparavant, vous pouvez reprendre le texte qui sera un prochain jour sur le site des éditions ([url]http://www.michalon.fr[/url]) :
« [i]Un chercheur universitaire en anthropologie, spécialisé dans la construction des mythes en histoire moderne, enquête sur Bernardo, le compagnon mutique et un peu benêt de Zorro. Cette recherche qui n’est ni du goût de l’université, ni de certains de proches à Monterey – où le mythe de Zorro est né – le mène en Californie, puis en Catalogne.
Il reconstitue une biographie de son héros à partir de documents glanés en bibliothèques. Il fait aussi la rencontre de femmes extraordinaires et se trouve mêlé à une histoire de meurtres en série qui lui évoque de façon évidente mais très ésotérique sa propre recherche et ses déductions sur[/i] (…) [i]un héros fabriqué pour des raisons historiques par une Amérique en construction cherchant à oublier le passé colonial.
Le lecteur suit deux histoires parallèles à deux cents ans d’écart mais s’interpénétrant sans cesse. L’auteur en profite pour écorner la recherche universitaire française qu’il connaît bien[/i]. ».
Pour crédibiliser le fait que vous aussi avez lu ce Bernardo avant tout le monde, prenez un air inspiré, et récitez la petite prière figurant au bas de la page 170.
[i]Verge, ya tine dessarmat, causa vera
Vos, per merce, guarnit-me de la spasa
Que par la mort de Jhesus fon romasa
Dins nostre cor tenint El la creurera[/i]
J’ai comme un doute sur la traduction donnée en note.
À mon sens, c’est plutôt [i]creura[/i].
Cela semble être la fin du [i]Fermant los ulls alt en l’amor eterna… [/i]
De Francesc de Mèscua, sans doute du valencien plus que du catalan.
(voir [url]http://www.rialc.unina.it/107.2.htm[/url])
Et la traduction donnée (ainsi que la date, 1440, incertaine), me semble emberlificotée, au point où je me demande si ce n’est pas la garde (de l’épée) qui est tenue par le Christ en notre for intérieur. Donc, intercession de la Vierge pour que, énonçant pacifiquement la vérité, l’épée du Christ soit de son côté.
Ah bah. Connaissant le vrai, on n’en est pas moins vulnérable.
Or Bernardo sait, enfin, saura, la vérité sur Zorro.
Je ne vous en dis pas davantage.
Au fait, pourquoi Bernardo ? Ah, c’est le nom d’un bateau.
Nul autre que le [i]sister ship[/i] de celui du Capitaine Crochet ! Non ? Si ! (oui, enfin, je n’en suis pas à un anachronisme près). 😉