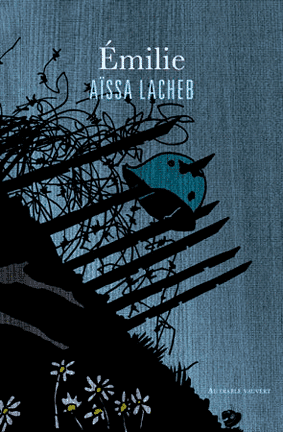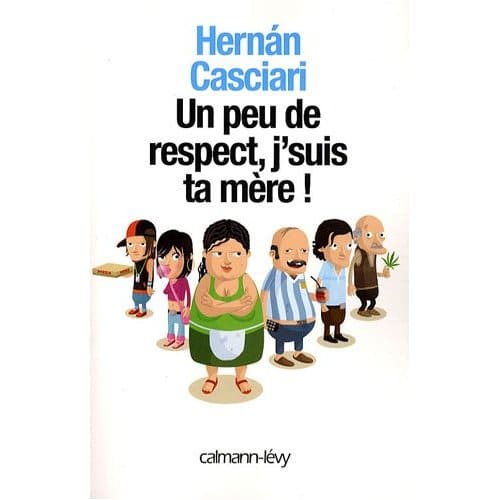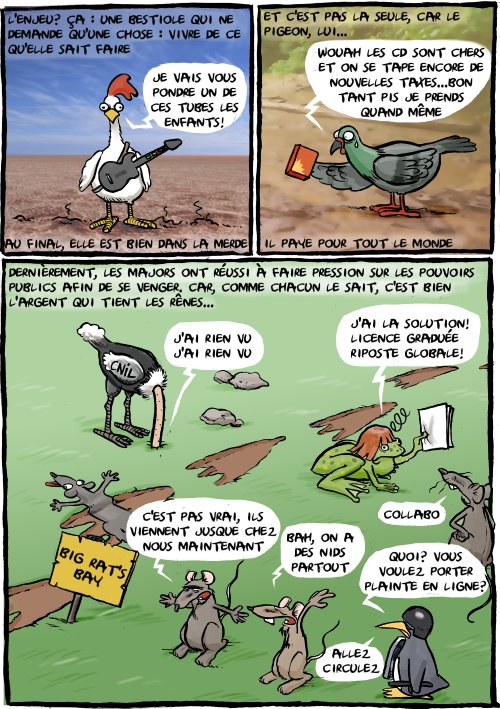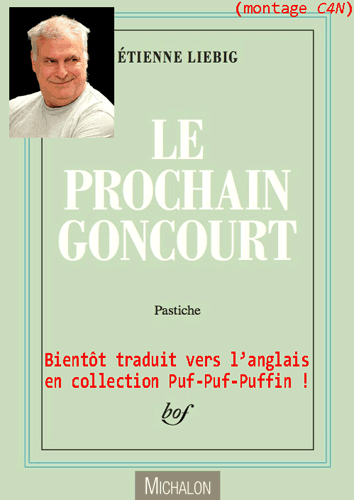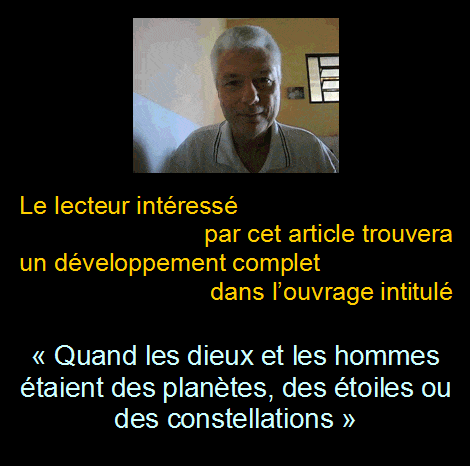C’est un condensé d’émotions, maîtrisé, aussi tamisé que la lueur hivernale d’une aube de bombardements. Le sujet : la Grande Guerre, vue côté allemand, à l’Ouest, parmi les frères d’armes d’un Erich Maria Remarque, là où erre une fillette mutique, Émilie.
Je ne sais si Aïssa Lacheb a écrit ce livre les yeux embués de larmes, mais sa lecture les fait venir aux paupières. Je ne sais non plus ce qui le lui a vraiment inspiré, tellement il tranche d’avec ses romans et essais antérieurs. Ce qu’il en dit ? Soit le récit de deux rescapés allemands de la première ligne de défense du mont Cornillet, dans les ruines presque totalement recouvertes d’éclats d’obus de l’ex-village de Nauroy. Sans doute. Peut-être, en amont, vers l’Aisne, le Chemin des Dames, si souvent revisité par les regrettés Yves Gibeau, écrivain, et Gérard Rondeau, photographe, qui en ont fait resurgir le souvenir dans les années 1990.
Un mot tout d’abord sur la couverture d’Olivier Fontvielle, très inspirée par la série de trois albums BD de Jacques Tardi sur la boucherie de 1914-1918, qui campe Émilie à découvert, recouvrant de branches et d’herbes les boueuses sépultures (comment employer « les tombes » ?) des fantassins allemands. Il fait subsister quelques pâquerettes en premier plan ; celles de naguère… Les fantassins sont terrés dans leurs tranchées, en proie à la panique, à l’abrutissement, au désespoir, à l’envie de se rendre pour éviter les « nettoyeurs » français qui achèvent les blessés, et trop souvent acculés à la folie, au suicide. Autre préambule : hormis celle la presse régionale du Grand Est, de France Bleue, et surtout de divers libraires subjugués, cet Émilie n’a pas eu encore la reconnaissance critique qu’elle mérite. Cela viendra… Assurément.
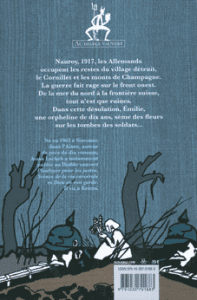 Condensé, contenu, étouffé
Condensé, contenu, étouffé
Les prières d’insérer vantent l’érudition de Lacheb, qui s’est amplement documenté sur le conflit. C’est tomber à côté de la plaque : si elle est indéniable, elle ne s’exprime jamais. Pas d’étalage, nul pittoresque, aucun détail inutile, l’auteur s’en tient à signaler, parcimonieusement, quand c’est indispensable, le calibre des obus qui vont ensevelir plus d’un millier de soldats sous le mont Cornillet, et la taille des éclats qui jonchent encore le site et bien au-delà. Toute cette contrée est restée domaine militaire pour l’interdire au public toujours exposé à des blessures encore parfois mortelles. Dialogues réduits au minimum… Récit court, mais si lourd, si dense. Lacheb ne cherche pas à « voir » par les yeux d’Émilie, devenue muette après avoir perdu sa famille et raté l’évacuation. Elle a dix ans à peine, et elle ne hurlera qu’une fois, hagarde, en voyant s’avancer le feu roulant de l’artillerie française. Les soldats lui parlent parfois dans une langue qui lui est inconnue, mais surtout par gestes et mimiques. C’est à travers les regards de ces soldats sur elle que Lacheb construit son récit avec une sobriété acérée. Mais quelle langue… Épurée au possible. On pense à Michel Doury, ex-officier de marine, devenu Sedanais, traducteur angliciste et auteur, à de rares autres n’écrivant qu’avec des mots simples, usant de litotes, écrivant « plat » – art formidablement exigeant –, mais avec une si poignante force évocatrice.
Petite princesse lunaire
Du mont Cornillet, en 1974, on extirpa des membres, rarement les cadavres entiers de quelques dizaines de soldats de divers régiments, puis l’année suivante, les restes de seulement 321. Nouvelle tentative en 1984, et exhumation de 265 corps, pour la plupart asphyxiés dans les travées et coursives de cet immense et immobile bâtiment. Puis on renonça à dégager les galeries effondrées, on reboucha les entrées obstruées plus loin, les tunnels et puits sans fond d’aération, ensevelissant de nouveau sans doute bien plus de 500 dépouilles. Aïssa Lacheb se rendit, le 20 mai 2017, pour le centenaire de l’offensive française, à une commémoration. Il gravit seul jusqu’au sommet, en clandestin s’exposant au dérapage sur le tapis d’éclats métalliques, à une explosion de munition encore munie d’un détonateur intact… « Du regard j’ai longtemps cherché Émilie (…) Il y avait une Émilie de son âge dans les archives départementales (…) J’ai senti sa présence (…) C’était une sensation puissante de douleur et d’espoir, un souffle violent et tendre à la fois. ». Cette dernière phrase est l’unique qu’il s’autorise pour résumer le ressenti qui imprègne tout l’ensemble de son récit, ô combien prenant, perturbant… déchirant, et même déchiquetant, emploierai-je pour traduire heartrending.
Quand elle n’est pas prostrée, Émilie vagabonde là où nul soldat ne s’aventure. Elle était sortie de sa ferme éventrée « couverte de fragments de peau, de chair, de sang ». Les soldats la retrouvent indemne, sanguinolente, avec « de la matière humaine, accrochée à sa chemise, [qui] glissait le long de ses bras, de ses jambes. ». Dès lors, elle n’émit plus un mot, passa son temps à recouvrir les cadavres de restants de végétation, car il n’est plus de floraison. Ce n’est parfois qu’une ombre qui remémore aux soldats leurs propres enfants, souvenir fugitif que chasse la mitraille ou les démangeaisons des poux, ou la soif et la faim, la douleur des blessures, un éclat de bois quand il faut consolider, en vain, la tranchée — tâche abrutissante, sans cesse renouvelée. Bien plus que l’inconscience d’Émilie, c’est la conscience des combattants – ceux des deux bords, même si les « bleus », les poilus, sont à peine esquissés –, ou plutôt leurs émotions, que l’auteur fait partager. Le père d’Aïssa Lacheb, un harki, n’avait pas été rapatrié indemne d’Algérie. Son fils mentionne les zouaves algériens qui menèrent l’assaut du mont Cornillet, incidemment, sans aucunement s’y attarder. À Reims, en 2014, fut érigée une réplique de la statue de Bamako honorant « la mémoire des armées noires ». Il en est une autre, différente, à Merfy, non loin de Reims, rappelant le sacrifice des tirailleurs sénégalais au château de Maretz, en mai 1918. Ce n’est pas du tout le propos d’Aïssa Lacheb, qui campe des soldats universels et conclut sur cette phrase de Soljenitsyne : « Comment l’humanité a-t-elle pu tomber si bas ? ».
Aïssa Lacheb ne s’est pas emparé du personnage d’Émilie en conteur champenois ou du Schleswig-Holstein, de Cochinchine ou d’ailleurs. Ses combattants n’ont ni nom, ni prénom, hormis un certain Hans, celui d’entre eux qui s’attache le plus à arracher un sourire à la fillette.
Cherchez ailleurs des allusions aux guêtres ou autres bandes molletières, aux insignes régimentaires : mal ravitaillés, ces soldats sont devenus des gueux, enviant parfois le sort du déserteur qu’ils sont forcés de fusiller sans le moindre ressentiment à son encontre ou celle de l’officier qui ordonne. Ils restent le plus souvent hébétés, et finalement si semblables à Émilie restée si près de son foyer détruit, mais dont le souvenir s’enfuit dans ce désastre méconnaissable, si ravagé qu’il ne peut plus évoquer rien d’autre que lui-même. Inutile de dessiner à Émilie un mouton : voilà des mois que le dernier a été mangé ou trop éclaté pour en récupérer des lambeaux. On ne sait ce qu’elle peut dessiner sur des feuilles souillées récupérées dans la mairie-école effondrée, mais on s’en doute : des explosions, encore, toujours des explosions. Peut-être, à l’arrière, un insolite ballon d’observation hors de portée des tirs adverses. Avec deux-trois avions, ce sont les seuls éléments du décor tranchant sur tout le reste, sur tout ce qu’il reste, faute de pouvoir subsister. Difficile de sortir indemne de ce roman, difficile aussi de ne pas le reprendre au début. L’entrée en matière, l’évocation du monde d’avant, c’est un extrait du cahier de doléances des gens de Nauroy, en 1789. Il suffit. À cette misère, au printemps 1917, rien ne succéda : strictement rien. Ni âme, ni bête, juste du fer et des ossements.
Émilie, Aïssa Lacheb, Diable Vauvert éd., fév. 2018, 128 p., 15 eur.